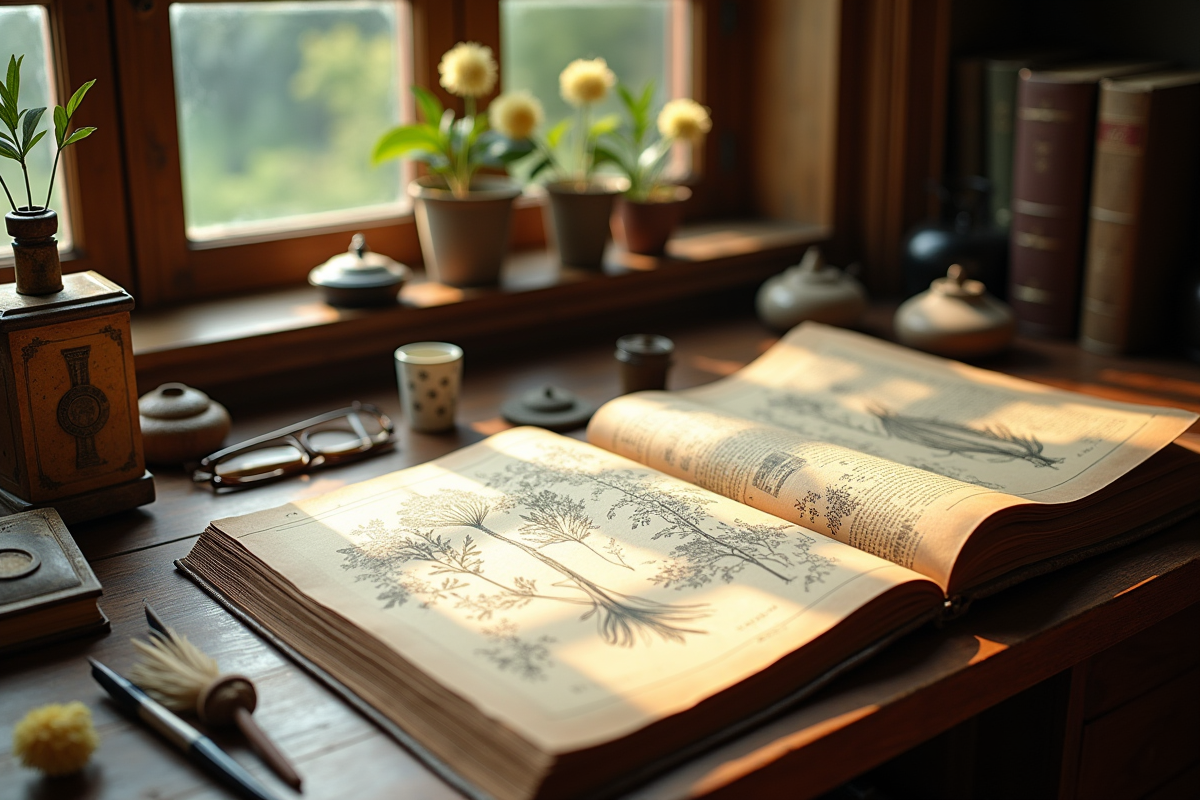Au XIXe siècle, les frontières entre sciences naturelles et chimie demeurent floues dans l’enseignement supérieur français. Les botanistes collaborent régulièrement avec des chimistes pour comprendre la structure intime des plantes.
Louis Eugène Bertrand, figure peu citée dans les manuels, contribue à poser les bases de la botanique moderne grâce à ses travaux sur la morphologie cellulaire. Son parcours illustre l’évolution rapide de la discipline, marquée par des débats scientifiques et des réformes institutionnelles majeures.
La botanique en France : un terreau fertile pour les sciences naturelles
Impossible de parler de sciences naturelles en France sans évoquer la botanique, qui a su s’imposer dès le siècle des Lumières comme un pilier incontournable. Lieu central de cette effervescence : le Jardin du roi, devenu Jardin des plantes après la Révolution, puis érigé en Muséum national d’histoire naturelle. Ici, savants, chercheurs et explorateurs ont croisé leurs chemins et leurs idées, donnant naissance à l’un des herbiers les plus riches au monde, cinq millions de planches, dont certaines voyagent encore aujourd’hui, jusqu’à l’université de Brisbane.
L’organisation de la classification botanique n’a rien d’un long fleuve tranquille. Partie des études morphologiques portées par Linné ou Jussieu, elle s’est ouverte, au fil des décennies, aux méthodes génomiques. Ce tournant marque un changement de cap dans la manière d’aborder le vivant, sous l’impulsion du Muséum national d’histoire naturelle et de sociétés savantes comme l’Académie des sciences ou la Société linnéenne de Paris fondée par René Desfontaines. Cette dernière, transformée en Société d’histoire naturelle de Paris, a été à l’origine de grandes expéditions, notamment celle menée par d’Entrecasteaux.
Voici quelques fondements qui expliquent le rayonnement de la botanique française :
- Le Jardin du roi, puis Muséum national d’histoire naturelle, fédère collections, enseignement et recherche sous un même toit.
- L’herbier du musée, véritable mémoire végétale, rassemble des planches venues du monde entier.
- Les sociétés savantes comme la Société linnéenne rassemblent botanistes et naturalistes autour de la découverte et de la classification botanique.
Cette dynamique collective, portée par les institutions, a permis à la botanique française de progresser à la croisée des explorations scientifiques et de l’innovation méthodologique, tout en assurant la transmission et la protection d’un patrimoine végétal unique.
Quelles grandes figures ont façonné l’histoire de la botanique française ?
Derrière le prestige de la botanique française, il y a des femmes et des hommes, des expéditions audacieuses et des collections extraordinaires. Dès le XVIIIe siècle, Louis Georges Leclerc, comte de Buffon, intendant du Jardin du roi, apporte un souffle nouveau. Il transforme ce jardin en creuset d’innovation, positionnant Paris comme centre névralgique des sciences naturelles.
Dans le même élan, Carl von Linné révolutionne la classification systématique : sa méthode hiérarchise la diversité du vivant et influence la recherche à travers toute l’Europe. À Paris, Antoine-Laurent Jussieu introduit la méthode des familles naturelles, une avancée qui façonne durablement les herbiers et les jardins. Des sociétés savantes se créent, comme la Société linnéenne de Paris fondée par René Desfontaines, qui deviendra la Société d’histoire naturelle de Paris.
Les expéditions botaniques s’intensifient. Jacques Labillardière, par exemple, accompagne l’expédition d’Antoine Bruny d’Entrecasteaux en Nouvelle-Hollande et rapporte plus de 4000 spécimens de plantes. Joseph Banks, correspondant de Labillardière, se fait connaître lors des voyages de James Cook dans le Pacifique. Les collections circulent, de Florence à Paris, de Londres à Amsterdam, dessinant les contours d’un patrimoine scientifique partagé à l’échelle européenne.
Pour mieux saisir l’impact de ces figures et de leurs réseaux, il faut retenir :
- Buffon, Linné, Jussieu : trois visions, trois manières d’ordonner et de penser le végétal.
- Labillardière, homme de terrain, marque la discipline par l’ampleur de ses collectes et la dispersion de son herbier.
- Les sociétés savantes et les expéditions internationales structurent la transmission des savoirs botaniques.
Bertrand, pionnier méconnu et acteur clé des avancées botaniques
Au cœur de l’effervescence des expéditions botaniques de la fin du XVIIIe siècle, le nom de Bertrand passe souvent au second plan. Pourtant, il croise la route de Jacques Labillardière, envoyé en Nouvelle-Hollande lors de l’expédition d’Entrecasteaux, et se distingue par son habileté à identifier des espèces rares, à organiser la collecte et la conservation des échantillons, même dans des conditions éprouvantes et face à la diversité des écosystèmes parcourus.
Pendant l’expédition, la Terre de Diémen livre quelque 4000 plantes, 1500 insectes et 300 oiseaux rares. Bertrand, épaulant Labillardière, joue un rôle clé dans la collecte de spécimens comme Lagenophora stipitata. Cette plante, récoltée sur les côtes australiennes, rejoindra plus tard les collections du Muséum national d’histoire naturelle et de l’Institut botanique de Florence. Les spécimens voyagent alors entre Paris, Florence et Londres, dessinant une nouvelle carte de la botanique européenne.
L’herbier de Labillardière, largement nourri par le savoir-faire de Bertrand, se disperse après le retour en France : une partie rejoint la collection de Philip Webb, une autre celle de Benjamin Delessert. Des objets glanés à Java prennent le chemin du Tropenmuseum d’Amsterdam. Les échanges entre institutions, comme le prêt de planches du Muséum national d’histoire naturelle à l’université de Brisbane, témoignent de la vitalité et de la portée internationale des réseaux tissés par ces naturalistes.
Voici ce que l’on peut retenir du rôle singulier de Bertrand :
- Discret mais déterminant, Bertrand a participé à la collecte et à la sauvegarde de matériaux devenus incontournables pour l’histoire de la botanique.
- Ses collaborations, notamment avec Labillardière, illustrent la diversité des profils et l’esprit d’équipe qui animaient les grandes expéditions françaises.
Explorer aujourd’hui : ressources, collections et initiatives pour passionnés de botanique
La botanique française n’a rien d’un art figé : son héritage continue de s’enrichir. Le Muséum national d’histoire naturelle veille sur un herbier de près de cinq millions de planches, alimenté par des expéditions historiques et des collectes récentes, dont celles de Bertrand et Labillardière. Ce trésor circule encore : certaines planches, comme celle de Lagenophora stipitata, ont pris la route de Brisbane pour des analyses croisées.
Sur le terrain, l’Office national des forêts pilote des Espaces Naturels Sensibles ouverts à la recherche et à l’observation. En 2024, la redécouverte de Carex hartmaniorum à Longué-Jumelles, absente depuis des décennies, mobilise botanistes et gestionnaires. Ce site, suivi de près par David Hamon et Emilie Vallez, accueille aussi des espèces comme Carex panicea, Cirsium tuberosum ou Succisa pratensis.
La connaissance se transmet aussi via des associations telles qu’Anjou Bota, ou lors d’événements dédiés aux collections botaniques : jardin des plantes, muséum des antiques, forêt de Monnaie. Héritiers directs de l’ancien jardin du roi, ces espaces favorisent les échanges entre chercheurs, passionnés et gestionnaires d’espaces protégés. Désormais, la découverte botanique ne se limite plus à la grande expédition : elle s’invente chaque saison, entre inventaires naturalistes et observation d’espèces rares ou peu connues.
La botanique n’a jamais cessé d’évoluer. Aujourd’hui encore, elle pousse ses racines à travers collections vivantes, réseaux de passionnés et découvertes inattendues, traçant de nouveaux chemins pour ceux qui choisissent d’explorer le végétal.